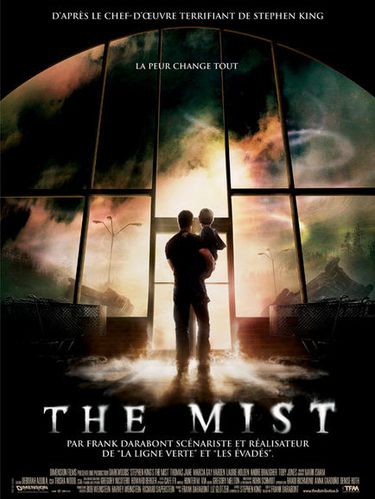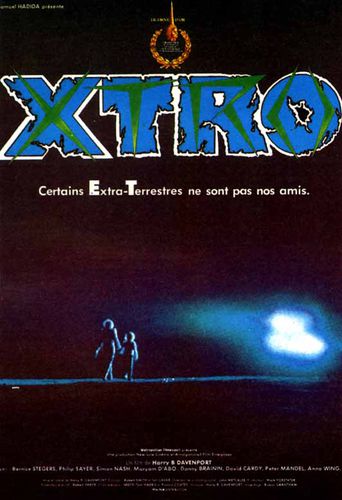1968. L'année de toutes les contestations et de tous les changements. Prague et son printemps meurtrier, Paris et son mai rouge et noir, le Vietnam qui pose problème, la course aux étoiles qui s'affole, les Beatles qui sortent un double album fondateur, les Rolling Stones qui chantent Sympathy for the devil, et David Bradley qui réalise They saved Hitler's brain. Cherchez l'intrus.
Quel dommage que les traducteurs français aient éprouvé le besoin de rebaptiser ce film On a volé le cerveau d'Hitler. Il faut croire par ailleurs qu'ils n'ont pas regardé le film avant d'opter pour pareille traduction, mais ça c'est difficile de leur en vouloir. En tout cas, il n'est nullement question de vol dans ce film, et ce « on » mystérieux est clairement identifié : ce sont des fanatiques nazis qui, on n'arrête pas le progrès, ont réussi à conserver intact le cerveau d'Hitler ainsi que la tête qui va autour, le tout soigneusement à l'abri dans un bocal. Cette fine équipe, réfugiée dans un bunker situé dans un petit pays d'Amérique du Sud, prévoit de lancer sur le monde un gaz abominablement mortel, obéissant (ou croyant obéir) ainsi aux ordres de celui qui n'aura jamais autant mérité le titre de « chef ».
On a du mal à croire que ce film a été réalisé dans les années 60 tant il ressemble à toutes ces séries Z des années 40 et 50 dont les plus célèbres sont naturellement les oeuvres inoubliables d'Edward Wood. A vrai dire, les seules marques de « modernité » qui transparaissent dans They saved Hitler's brain réside d'une part dans les petits accents funky de certaines musiques, et dans le look de quelques personnages, lunettes de soleil et grasses moustaches, qui n'est pas sans rappeler celui des acteurs pornos dans les basses productions américaines des années 70. En-dehors de cela, voilà un film qui semble une survivance anachronique des navets des décennies qui le précèdent, avec sa réalisation statique, ses acteurs dont on jurerait qu'ils ont tous un balai enfoncé dans le cul, et son intrigue sans queue ni tête qui se donne au choix des allures de film d'espionnage ou de film de guerre, sans jamais parvenir à se fixer de manière précise.
Evidemment, il était inutile d'espérer un miracle. Avec un titre comme They saved Hitler's brain, on était en droit de s'attendre à de la kitchouille au kilo. J'étais d'ailleurs ravi de pouvoir enfin regarder ce film, tant on ne croise pas tous les jours des machins pareils. L'ennui, c'est que face à ce genre de productions, je me marre pendant trente minutes et puis je finis par m'emmerder méchamment. Repérer les incohérences, noter la platitude des dialogues, s'amuser de l'amateurisme de la réalisation sont des loisirs qui n'ont qu'un temps. Découvrir enfin la tête d'Hitler trônant dans son bocal et esquissant des sourires sardoniques fut encore l'occasion de m'arracher un sourire, mais dans l'ensemble mon ennui était déjà manifeste et je suis obligé d'avouer que j'ai terminé le film en ne le suivant que d'un oeil, une grille de mots croisés sur les genoux pour passer le temps.
A noter que le dvd est édité par Bach, une maison spécialisée dans la vente de films libres de droit à petit prix, sans aucun travail de remasterisation et avec des sous-titres d'une rare médiocrité. On a donc droit à une image craquelée et à un son merdique au possible, mais les traducteurs ont fait moins de faute d'orthographe que d'habitude. C'est déjà ça.
Je ne déconseille pas They saved Hitler's brain : c'est un film culte dans le registre de la SF ahurissante de connerie. Une vaste farce qui se prend au sérieux, que les amoureux de nanars trouveront forcément à leur goût. Mais vous l'aurez compris, inutile de perdre votre temps à regarder ce film si vous n'êtes pas d'humeur à prendre les choses au trentième degré minimum.
Sur ce je vous laisse, et si vous vous demandez pourquoi un scientifique juge nécessaire de prouver les effets dévastateurs d'un gaz sur l'homme en montrant les images d'un éléphant atteint de narcolepsie, je me le demande aussi, mais c'est la dure et sombre loi du stock-shot et personne n'y peut rien, pas vrai ?